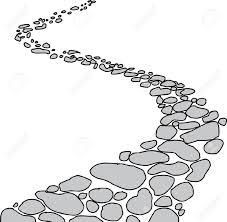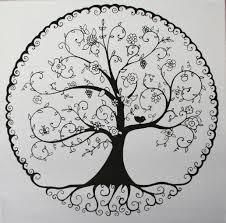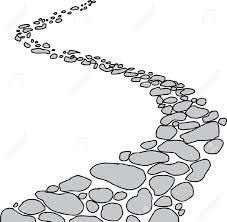AFRIQUE : LES PRINCIPALES ENTRAVES À L’ÉMERGENCE (2)

L’éducation traditionnelle. La culture du suivisme et ses avatars


Écrire un livre, un essai, est-ce transgresser ?
J’ai eu la surprise, un beau matin en me rendant par hasard sur un site : Africamaat, de découvrir des critiques dont j’étais l’objet, sans que j’en sache les raison précises. Sauf qu’on semblait me reprocher d’avoir été honoré des Palmes académiques ! Et d’avoir « ciré les bottes du Blanc » pour obtenir cette distinction ! Quand ? Quel Blanc ? Comment ?
On commençait par une esquisse des origines de cette distinction, mise en place par Napoléon…
Et les diplômes universitaires et professionnels que j’ai pu acquérir ? J’ai aussi léché les bottes du Blanc pour les acquérir ?
Dans cette série d’articles, j’étais associé à un certain Bernard Lugand, que je ne connaissais pas à l’époque.
Comment peut-on critiquer en ces termes quelqu’un dont on ignore tout, dont on ignore le parcours, les intentions, à qui on n’a jamais posé de questions, ni demandé d’explication ?
Les auteurs de ces propos malveillants à mon égard, allaient jusqu’à me traiter de raciste ! Et ce, sans la moindre justification ni preuve.
Parmi eux, certains ont une conception originale de l’historien. Pour eux, en effet, l’histoire, c’est dire ce que l’on a envie d’entendre, et taire ce qui gêne.
Or, quel peuple, quelle nation au monde n’a pas de pages sombres dans son passé, voire sa part des brûlures de l’histoire ?
Se refuser à regarder en face ces pages sombres de son histoire, c’est se condamner à les revivre.
L’écriture de l’histoire est exigence. Il existe des règles précises et une éthique qui s’imposent à l’historien, lequel doit s’engager à n’écrire que ce qui s’est réellement passé, qui est vérifié, confirmé par les faits, les preuves, même s’il en souffre personnellement ,moralement, et même si cela porte tort à ses intérêts, à ses sentiments, à son pays… L’histoire est ainsi la discipline sans doute la plus exigeante.
Mais je préfère de loin les critiques justifiées. Mieux, je préfère de loin les critiques qui élèvent, celles qui permettent de progresser et de faire progresser, bref, les critiques qui construisent et enrichissent celui qui en est l’objet comme celui qui les formule, non les critiques stériles dont le seul objet semble être de nuire.
Mais, il n’y a pas de place dans mon cœur pour la rancune ou le ressentiment. Aussi, je n’en veux aucunement à ces illustres inconnus qui m’ont ainsi attaqué à visage couvert. J’aurais simplement souhaité qu’ils soient un peu plus explicites, et précisent les fautes ou erreurs que j’ai pu commettre, afin que je puisse y réfléchir, en vue de me corriger et m’améliorer, si besoin.
Cependant, quoiqu’il en soit, et malgré tout, je leur suis redevable d’avoir élargi et enrichi un peu plus mon champ de réflexion sur l’Humain.
J’ai été aussi l’objet d’autres critiques portant sur mes opinions exprimées dans quelques-uns de mes livres, des essais, ou lors de conférences, mais à ce jour, à ma connaissance, ces critiques proviennent spécifiquement de « frères africains », et jamais directement sous forme de débat ou de confrontation d’idées. Or, toutes mes opinions dans des essais ou lors de conférences, ont pour objectif de susciter le débat, de confronter différents points de vue, pour un enrichissement mutuel. J’ai toujours aimé exposer mes idées sur des sujets divers, échanger et partager avec d’autres. Je n’ai jamais prétendu avoir la science infuse. Malheureusement, je fais le constat, que pour certains, la critique stérile, sinon les injures tiennent lieu de débat ou de confrontation d’idées, comme si ces personnes promptes à critiquer sans savoir, à condamner sans comprendre, ni connaître, ignoraient le but d’une conférence ou le sens de l’essai.
Une conférence est une réunion publique au cours de laquelle le conférencier, expose sa thèse sur un sujet, afin de la confronter avec les auditeurs. Autrement dit, il s’agit d’un échange dont le but est d’apporter un éclairage sur une question, en vue d’un enrichissement mutuel.
Personne n’est obligé de se taire lorsqu’il a un avis opposé ou différent de celui du conférencier. Encore faut-il le faire savoir en s’exprimant publiquement. C’est tout le sens et tout l’intérêt d’une conférence, de la présence d’un conférencier (ou conférencière) devant un public.
La même définition s’applique à un essai, un livre qui traite un sujet et qui le soumet à la confrontation publique. Ce qui diffère du roman ou d’autres genres littéraires.
Quel est donc l’objectif visé par ceux qui assistent à des conférences sans rien dire quand ils ne sont pas du même avis que le conférencier, et qui attendent d’être chez eux pour sortir les « longs couteaux » ?
Mon premier livre : L’Afrique malade d’elle-même(1), publié en France en 1986, fut en réalité conçu et écrit en Afrique.
Ce livre invite à une immersion dans les profondeurs des réalités africaines : politiques, sociales, économiques, culturelles, humaines…
L’Afrique malade d’elle-même est le fruit de plusieurs années d’observation de ce continent et de ses maux, et de réflexion sur les moyens d’en sortir, de se relever. Ce n’est ni un roman, ni un pamphlet.
Une carrière d’enseignant, dans des pays africains différents, d’abord comme instituteur, directeur d’école, puis comme professeur, fut pour moi un observatoire privilégié, incomparable, pour observer, écouter, réfléchir.
Quelques mois après la sortie de ce livre j’ai reçu (via mon éditeur) le commentaire d’un lecteur africain installé en Suisse, commentaire publié dans un quotidien de ce pays et ainsi libellé :
« Ce qui est surprenant, c’est que l’auteur de ce livre, M.D. utilise des termes qu’on a l’habitude de lire ou d’entendre de la part des Blancs. Que cela vienne d’un Africain est une première. »
J’aurais aimé qu’il donne son opinion sur les thèmes abordés dans le livre, sur les objectifs de l’auteur. J’ai eu l’impression que ce lecteur semblait plus intéressé par l’identité de l’auteur que par le contenu de l’ouvrage.
Visiblement, et comme le dit si bien la chanson de Brassens : « Non, les braves gens n’aiment pas qu’on suive une autre route qu’eux ».
Un conditionnement des esprits par la « culture du suivisme » ?


Désolé, je ne suis pas Congolais, Guinéen… !
Je ne suis ni Congolais, ni Gabonais, Sénégalais, pas plus que Guinéen ou Nigérien… En revanche, j’ai conscience de partager avec eux, comme avec tous les peuples de ce continent, un même héritage historique et un même devoir de relever quelques défis communs, ce qui implique , de fait, une solidarité de conscience.
Je ne suis pas non plus le sosie ou le clone de mon père, encore moins de mon grand-père…


Originalité et authenticité
Je ne suis ni Ghanéen, ni Mauritanien...! Je ne suis pas non plus le clone de mon père. Je suis moi, un homme libre et pensant, un homme libre et responsable, libre de mes actes.
J’ai manifesté très tôt, la volonté de penser par moi-même et d’agir en être responsable de ses actes. Je ne me suis jamais senti obligé de penser comme les autres, de faire comme les autres.
Et, très tôt, j’ai posé un regard critique sur ce, et sur ceux qui m’entouraient ; d’abord dans ma famille. Les parents, étonnés, parfois inquiets de la précocité de mes idées, de leur étrangeté aussi sans doute ont accepté que je puisse les exprimer, sans qu’ils puissent toujours les comprendre eux-mêmes, ou les partager.
Ma famille ne m’a jamais interdit ni de penser, ni d’exprimer mon point de vue sur nombre de sujets.
J’ai écrit mon premier livre quand j’étais en classe de première au lycée, à 17 ans. Dans ce livre qui ne fut jamais publié, je portais un regard critique sur un certain nombre de pratiques que je désapprouvais dès l’âge de 13-14 ans, voire avant, parmi lesquelles le mariage forcé, le mariage précoce, l’excision, le fait que les épouses se mettent à genoux quand elles devaient parler à leur mari…
Dans ce premier livre de lycéen, j’émettais ainsi quelques réserves sur la condition des femmes. J’avais constaté que celles que j’observais travailler dans les champs, portaient le grand et beau boubou blanc, parfois sous un soleil accablant. Celui-ci devait les gêner et rendre le travail plus difficile.
Je suggérais que lors de ces travaux, soit prévue, pour elles, une tenue moins ample qui rendrait plus facile les mouvements et gestes. Le but étant de rendre ce travail un peu moins pénible. Le grand boubou blanc serait réservé pour les jours de fête ou au repos chez elles.
J’émettais aussi quelques critiques contre la dot telle qu’elle était pratiquée dans la plupart des sociétés d’alors. J’y voyais un « achat » de la femme par son futur mari. Le mariage m’apparaissait ainsi comme un esclavage déguisé, sans compter la lutte combien difficile et solitaire dans ma famille pour la scolarisation de tous les enfants, filles et garçons.
De même, je n’aime pas le tamtam (l’aversion pour cet instrument est liée à quelques épisodes de mon enfance). Je ne danse pas, et cela ne manque pas.
Si je n’aime pas le tamtam, en revanche j’aime la kora et le xylophone, la musique classique. Je n’aime pas non plus le jazz, mais j’apprécie le gospel. Je n’aime pas le rap mais j’aime le reggae.
Dans mes opinions comme dans mes goûts, dans mes rapports aux autres, j’ai toujours manifesté une indépendance d’idées, mais également une franchise et une loyauté sans faille. Je ne sais pas faire semblant. Je ne sais pas me déguiser.
Autre trait de caractère inné : sans être un taiseux, je n’ai jamais été un boute-en-train (caractère peu compris ou peu apprécié dans mon milieu). Je préfère écouter les autres et réfléchir, n’intervenant que quand cela me semble utile et pertinent.
Je ne sais pas singer. J’assume mes opinions et mes goûts, quoiqu’il m’en coûte, autre manière d’exprimer cette liberté sans laquelle je ne me sentirais pas moi-même.
Dès le plus jeune âge j’ai toujours été réfractaire au panurgisme, à la culture du suivisme, tête baissée et bouche cousue.
La liberté c’est la vie.

(1) Dans tous les pays d'Afrique où j'ai servi, j'ai écrit soit au ministre de la Fonction publique, soit au ministre de l’Éducation nationale, le plus souvent aux deux à la fois pour leur demander de me recevoir afin que je leur parle de mon expérience, en leur dressant le tableau des revers que j'ai pu constater dans les services administratifs ainsi que dans les écoles. Si une seule de ces personnalités avait daigné me recevoir (ou seulement me répondre), me donnant ainsi l'occasion de m'exprimer, l'idée d'écrire ces pages ne me serait certainement pas venue.
Le dialogue démocratique, libre et confiant est chose difficile, voire impossible en Afrique noire. A défaut d'un tel dialogue, il ne me reste plus qu'à déballer le linge sale sur la place publique. Susciter la réflexion et favoriser ainsi l'introspection constructive sont les buts assignés à ces propos, car, pour le présent et pour l'avenir de l'Afrique, j'estime que toutes les vérités sont urgentes à dire.
Tidiane Diakité
Avant-Propos: l'Afrique malade d'elle-même


Quelques observations de lecteurs et articles de presse
Tidiane Diakité, l’enseignant-né, mais venant de loin.
Le voyage est si long et si court entre le Mali d’où il vient, la Bourgogne où il se marie et la Bretagne qui l’accueille. « Les racines, je les ai dans le ventre » dit Tidiane Diakité. Habitant la Bretagne, aujourd’hui. « Foulant le sol rennais pour la première fois, arrivé vers 18 heures, sorti à 19 heures humer l’air de la ville. La première personne que j’ai abordée et avec qui j’ai causé un peu (un Breton !), en sortant de mon hôtel, m’a dit : « Vous verrez, les Bretons ne sont pas accueillants. Vous ne vous ferez pas d’amis ici. »
Ici qu’il a noué ses plus fortes relations, indéfectibles.
D’ici qu’avec le recul il repense à son père paysan qui ne savait ni lire ni écrire et dont il était le fils aîné ! « Opposant farouche » à sa scolarisation, il gardera toujours sur lui les bulletins ou les tableaux d’honneur, les montrant à ceux qu’il croise, à Bamako, en faisant ses courses ou dans la famille.
Revenir sur le chemin de Tidiane Diakité, c’est ouvrir un compas dont la pointe creuse un trou à Cuba, où il est envoyé d’office par des crédits de propagande alors qu’il ne souhaite qu’aller à l’université pour devenir enseignant. A Cuba, l’accueil est excellent, la samba et le reste, mais même pas possible d’aller en fac perfectionner l’espagnol ! Puis le compas se fiche au Sénégal, en Côte d’Ivoire pour, côté crayon, continuer le récit à l’université de Dijon. Vaches maigres en Bourgogne. Emmaüs pour loger et les pochons de restes donnés par un étudiant hollandais.
Le voilà professeur d’histoire, son rêve. Le voilà père de deux enfants et accueilli par sa belle famille. Le couple répond à un appel de professeurs en Côte d’Ivoire d’où ils sont débarqués brutalement, contrat résilié, direction Rennes !
« Non seulement, dit-il, on est Breton, mais retourner en Bourgogne eût été une punition ! » D’un duché l’autre se rejoue quel antagonisme ? C’est que « les Bretons ont une double identité : l’enracinement et l’ouverture ». Il sent cette Bretagne « au-delà du visible », il aime ces « Bretons distants, méfiants » et quand « on passe un cap, la confiance est là ». Tidiane Diakité jamais n’a senti un quelconque rejet, lui qui se dit « original » depuis son enfance malienne et « original » ici.
Jamais il n’a supporté les mariages forcés et quand les « tam-tam venaient », enfant, il fonçait en brousse en se bouchant les oreilles. Adolescent, il a rendu à sa mère les « grigris du cou ou du poignet », convaincu de leur ineptie. « Original » ici, impliqué dans au moins trois associations, car « il a dû élaguer » !
« Quand j’entends des gens dire ici que les Africains ont la danse dans le sang, je suis assez confus pour leur dire que moi, je n’ai absolument rien dans le sang ». Tidiane Diakité danse avec les idées, voilà le secret !
Gilles Cervera, Revue Place Publique, mai-juin 2013.

Tidiane Diakité, l'Afrique et son histoire chevillées au corps
Portrait
Tidiane Diakité est né au Mali, lorsqu'il était encore une colonie française. Il a fait ses études à Bamako où il a obtenu le bac. Il devra mettre de côté son souhait de faire des études d'histoire pendant près de dix ans. Il sera d'abord envoyé contre son gré à Cuba pour y taire des études de journalisme.
Interdit de retour au pays pour avoir quitté Cuba, il devient successivement instituteur et professeur de collège au Sénégal, où il tentera sans succès de s'inscrire comme étudiant à la faculté d'histoire de Dakar. Après que sa titularisation en tant professeur lui a été refusée à cause de sa nationalité étrangère, il part enseigner en Côte d'Ivoire, où il attendra en vain des cours d'histoire par correspondance. Il se décide alors de partir faire ses études à Dijon (Côte-d'Or), qu'il finance grâce à des petits boulots.
Enfin docteur et agrégé d'histoire, il enseigne pendant trois ans en France et y rencontre sa future femme, également professeur. Le couple part ensuite enseigner cinq ans en Côte d'Ivoire. Tidiane entreprend alors d'écrire son premier ouvrage, L'Afrique malade d'elle-même. Au terme de son contrat avec la Côte d'Ivoire, le couple enseignera dans l'académie de Rennes.
Tidiane Diakité profite désormais d'une retraite pour le moins active. Outre l’écriture, il est très souvent sollicité pour donner des conférences à la demande d'associations ayant un partenariat avec l'Afrique ou des établissements scolaires ou universitaires, un peu partout en France.
Il est l’auteur de plus d'une dizaine d'ouvrages
Ouest-France, 30 juillet 2013

(Au directeur des Éditions Arléa (2011))
Bonjour,
Je vous joins le dernier Numéro de la revue mensuelle
"Angle d'Attac 92", comportant mes NOTES de lecture enthousiastes sur un livre (judicieux cadeau reçu pour mon anniversaire !) écrit par une personnalité Tidiane Diakité.sur la situation de l'Afrique et les perspectives de ce continent.
J'ai beaucoup apprécié cet ouvrage : "50 ans après, l'Afrique" et je le recommande chaleureusement à tous ceux et celles qui veulent lire des réflexions, analyses, propositions faites de manière franche, sans langue de bois, mais constructive !
Par votre intermédiaire, j'ai donc le plaisir de transmettre à Tidiane Diakité mes félicitations et mon hommage. Merci
Cordiales salutations aux Editions ARLEA ;
Jean-Louis MICHNIAK Militant altermondialiste et socialiste,
Ancien Délégué du Personnel CGT dans I'Industrie aéronautique,
Membre du C.A. de l'association ATTAC / 92.